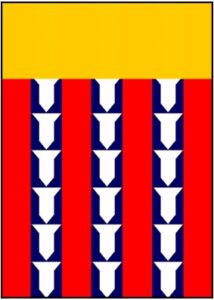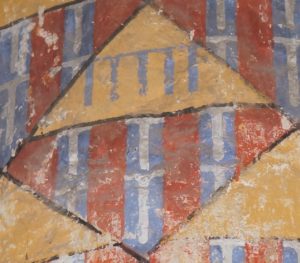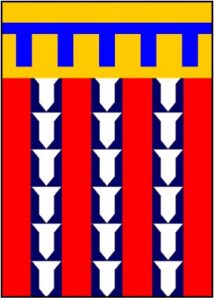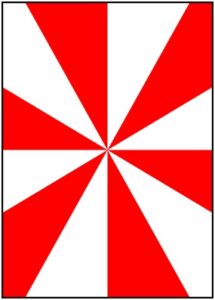Par Positions... Extérieur Inconnue Intérieur
Par Pièces / Parties édifice... Abside Annexe Bas-coté gauche Bas-côté est Bas-côté nord Bas-côté ouest Bas-côté sud Bibliothèque Cage d’escalier Cave Cellier Chambre Chambre de parade (de parement) Chambre de retrait Chambre des cloches Chambre du roi Chapelle Chapelle d'axe Chapelle latérale Chapelle latérale nord Chapelle latérale sud Chemin de ronde Chevet Châtelet d'entrée Chœur Cimetière Claire-voie Clocher Clocher-Porche Cloître Colombier Combles Corps de bâtiment nord Corps de bâtiment ouest Corps de bâtiment sud Corps de bâtiment sur rue Corps de garde Cour Croisée du transept Crypte Cuisine Donjon Déambulatoire Échauguette Eglise Escalier (extérieur) Façade Galerie Galerie est Galerie nord Galerie ouest Galerie sud Grande chambre Grande salle Guérite Inconnue Infirmerie Loggia Logis Moulin banal Mur d'enceinte Mur exterieur Mur pignon Narthex Nef Parvis Pavillon (château) Pavillon d'entrée Pile de pont Porche Portail Porte urbaine Portier Poterne Préau Remparts Rond-point Réfectoire Sacristie Salle Salle capitulaire Salle de garde Salle de justice Salle du trône Sanctuaire Scriptorium Tour Tour de l'enceinte Tour est Tour porche Tour à feu Tourelle d'escalier Transept (bras nord) Transept (bras sud) Travée sous clocher Vestibule loge
Par Emplacements précis... Abside Aile sud Arc Arc doubleau Arc formeret Arc triomphal Arc-boutant Archère Armoire (à reliques ou liturgique) Au pied des marches Au pied du maître-autel Autel Baie Baie d'axe Banc seigneurial Bassin Bretèche Caisson II Caisson III Caisson IV Caisson VI Chaire à prêcher Chapelle Chapelle absidale Chemin de ronde Cheminée Chœur Clôture du chœur Colonne Colonne droite Colonne gauche Colonnette Contrefort Coté épître Coté évangile Couronnement Croisée du transept Crucifix Cul-de-four Côté est Côté nord Côté ouest Côté sud Ecoinçon Enfeu Entrée Escalier/rampe Fenêtre Fondations Fronton Fût IIIe entrait IIIe poutre IIe entrait IIe poutre IVe entrait IVe poutre Ier entrait Ier niveau Inconnu Ière poutre Jubé Lucarne Maître-autel Mur Mur de refend Mur est Mur gouttereau Mur nord Mur ouest Mur pignon Mur sud Niche Oriel Pignon Pilier Pilier cornier Pilier droit Pilier gauche Plafond Portail Porte Porte cochère Porte d'entrée Porte latérale Poteau de justice Près du mur de la nef Rosace Sol Sépulture Tabernacle Toiture Tour Travée Travée tournante Tribune VII entrait VIIIe entrait VIe entrait Ve entrait Volée d'arc-boutant Voûte au nord-est au nord-ouest au sud-est au sud-ouest culée d’arc-boutant rond-point travée IIIème travée IIème travée IVème travée Ière travée VIIIème travée VIIème travée VIème travée Vème
Par Supports armoriés... Accolade Allège Antependium Appui de fenêtre Arc Arc doubleau Arc formeret Architrave Archivolte Baie Banc seigneurial Bande faîtière Banderole Bannière Biseau Blochet Boiseries et mobilier Borne Bâton Bénitier Cadre Caissons Carreau Carrelage Chapiteau Charpente Cintre Clef Clef d'arc Clef de la porte Clef de voûte Cloche Closoir Console Contrefort Corbeau Cordon Corniche sous toit Couvercle Croix ou calvaire Crossette Créneaux, merlons et couronnement Cul-de-lampe (culot) Dais Dossier Édicule Embrasure Entablement Entrait Epitaphe Fausse baie Fleuron Frise Fronton Fût de colonne Gable Gable de la porte Gargouille Girouette Gisant Heurtoir Hotte de cheminée Inconnu Inscription Intrados d'arc Jambage de cheminée Lambris Linteau Linteau de cheminée Linteau de fenêtre Linteau de porte Litre funéraire Lucarne Manteau de cheminée Maquarnas Meneau Miséricorde Mobilier Montant Monument funéraire Mur Mur nord Mur sud Mâchicoulis Ogive Oratoire Orfèvrerie Panne Panneau Panonceau Parois Pendentif Pied-droit Pierre inscrite Pierre sculptée Pignon Pilastre Pilier Piédestal Planche de rive Planche de sous-face Plaque sculptée et/ou inscrite Plate-tombe Poinçon Poteau Poteau cornier Poutre Relief Remplage Retable Sablière Sarcophage Socle Soubassement Soubassement de tombeau Stalle Statue Tableau peint ou sculpté Tapisserie Tombeau Treillage Trumeau Tympan Vantail Verrière Voussure claveau pinacle
Par Lieux de conservation... Airvault, Musée Jacques Guidez Amboise château (dépôt lapidaire) Beauvais MUDO-Musée de l’Oise Bourbon-l'Archambault Musée Augustin Bernard Brux, église Saint-Martin Castelnau-Montratier mairie Charroux, 4 rue de l'église Couhé, 91 Grand rue Coulommiers, église Saint-Denys-et-Sainte-Foy Dienville Trésor des églises du Parc naturel de la Forêt d'Orient Dissay, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Déplacée dans le même monument Fontmorant, La Chapelle-Bâton In situ Jugon-Les-Lacs 15 rue du Four Kerlouan, lieu-dit Saint-Sauveur L'Isle-Jourdain, 13 avenue Marcel Giraud L'Isle-Jourdain, 6 rue des fontenelles La Chapelle-Bâton, 2 Le Bourg La Roche-Posay, 17 rue Burbon La Trimouille, église Saint-Pierre Lagrasse Maison du patrimoine Landunvez, lieu-dit Trémazan Le Mans Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt Le Mans Musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt Le Vigeant, 20 rue Alexandre Bessaguet Lieu inconnu Locronan, musée municipal Charles Daniélou Loudun, église Saint-Pierre Lusignan, 29 petite rue saint-Louis Lusignan, 9 place du Gouverneur Lussac-les-Châteaux, Musée La Sabline Molsheim église de la Sainte-Trinité et de Saint-Georges Montpezat-de-Quercy chemin des Remparts Mortemart 1 rue des Augustins Morthemer (Valdivienne) Moulins Musée Anne de Beaujeu Mours, Pères Blancs Mériel, église Saint-Eloi Niort, Musée Bernard d'Agesci Paris, Cour d'Appel Paris, Musée Carnavalet Paris, Musée de Cluny Paris, Musée du Louvre Paris, basilique Saint-Denis Pièce disparue Pièce remployée Plaisance, mairie Plougonvelin, pièce erratique Plouider, lieu-dit Dourmap Plounévez-Lochrist, lieu-dit Croas Kermorvan Plouvien, Musée Skolig Al Louarn (75 rue Laënnec) Plouédern Poitiers, Hotel Fumé MSHA Poitiers, Hotel de l’Échevinage et des Grandes Ecoles (SAO) Poitiers, Musée Sainte-Croix Poitiers, Musée Sainte-Croix, réserves Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h, Cotiskoul vian, route de Rosnoën Propriété privée Puylaroque 1 rue Reynies Quimper 24 rue du Parc Quimper, Musée départemental breton (collections en exposition permanente) Royaucourt-et-Chailvet église Saint-Julien Saint-Martin-l'Ars, abbaye Notre-Dame de la Réau Salles-Curan cour jouxtant l'église Saint-Géraud Saulgé route de poilieux Sibiril, église Saint-Pierre Soissons Musée ancienne abbaye Saint-Léger Tonquédec, château de Tonquédec Tours, 5 rue de la Bazoche Tours, Musée de Beaux-Arts Tours, Société archéologique de Touraine, dépôt lapidaire Troyes, Musées d'Art et d'Histoire Vincennes, château (chapelle) route de Keriel
Par Techniques... Email Faïence Ferronnerie Fusion en bronze Glaçure Graffiti Image gravée Inconnue Menuiserie Peinture Peinture murale Peinture sur bois Peinture sur toile Peinture sur tôle Peinture à l'huile Plâtre Relief en bois Relief en bois peint Relief en cuivre Relief en metal Relief en pierre Relief en pierre peint Sculpture en bois Sculpture en pierre Sculpture en pierre polychrome Sculpture/relief en plâtre Terre-cuite vernissée Vitrail
Par Périodes... 1151-1175 1176-1200 1201-1225 1226-1250 1251-1275 1276-1300 1301-1325 1326-1350 1351-1375 1376-1400 1401-1425 1426-1450 1451-1475 1476-1500 1501-1525 1526-1550 1551-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001- Datation inconnue
Par Attributions... Aban de famille Abbaye Notre-Dame du Val Abbaye Saint-Jean-Baptiste du Jard Abbaye de Lagrasse Abbé de Notre-Dame de Celles Acolle Maire de Aigrefeuille Raymond de Alençon famille Alexandre Charlotte Alichamp famille Allegrain Jeanne Allemagne Jean de Allemagne de famille Allemagne, Florent d' Alliance inconnue Alligret Henriette Alory Marguerite Alory famille Alphonse de Poitiers Amboise Marie de Amboise, Jean III d' Amboise, Jean d' Amboise, Pierre d' Amboise, famille Anché Pierre de-Pardillan/Rivière Ysabeau Andlau Rudolf de Angier Jeanne Angleterre Edouard Ier de Anjou Charles Ier d' Anjou, René Ier de Appelvoisin Bernard de Appelvoisin brisure Appelvoisin famille Appelvoisin-inconnu Aquitaine Aliénor de Aragon Aragon Jacques Ier Aragon Pierre III de Archiac, famille Archiprêtré de Loudun Ardillon, François Arma Christi Armagnac Catherine de Armagnac, Charles Ier d' Armagnac, Jean V d' Armoirie bûchée Armoirie d'abbé Armoirie d'archevêque ou cardinal Armoirie d'attente Armoirie de prêtre Armoirie de roturier Armoirie effacée Armoirie hypothétique Armoirie illisible Armoirie inconnue Armoirie perdue Armoirie remployée Armoirie repeinte Armoirie restaurée Armoirie retaillée Armoirie vierge Armoirie à monogramme Arnoult, Claude Arsonval Jean de Artois Robert II d' Aubaneau, famille Aubert, famille Aubusson, Pierre d' Audayer (Audager) famille Audley/La Ward, famille Audoin famille Aunay, Robert d' Auvergne Guillaume XII de Auvergne Jean Ier de Auvergne Jeanne Ière de Auvergne Marie Ière de Auvergne Robert VII de Auvergne famille Auvergne, Jeanne II de (Jeanne de Boulogne) Availloles, Joachim d' Avaugour famille Aymar (Aymard) Louis Aymer, famille Balue, famille Bar Denis de Barbazan, Arnaud-Guilhem de Baskerville, famille Bastard, famille Baulne Guillaume de Bauçay, Hugues VI de Bavière Isabeau de Bavière Marguerite de Beaujeu Imbert de Beaujeu famille Beaujeu, Marguerite de Beaumont (d'Anjou), famille Beaumont Agnès de Beaumont Jean de Beaumont Richard II de Beaumont Roscelin II de Beaumont famille Beaumont-Bressuire famille Beaumont-Brienne Jean de Beaumont-Brienne Louis de Beaune Jacques de Beauvarlet, Mathieu de Beauveau Jeanne de Beauville famille Beauvoir famille Beauçay famille Belleville famille Belloy famille Bellère, famille Bermingham, famille Bernard Raymond de Bernard d'Albi Bernard de Farges (de Fargis) Bernes Gabriel de Berry Marie de Berry, Jean de Berthelot, René Berthelot, famille Berthier de Bizy Charles Besançon Guillaume de Bigot famille Blanche de France Blois Étienne de Blois-Châtillon Jeanne de Blois-Châtillon famille Boilève Jacques Boilève, Nicolas Boilève, famille Boinet, famille Boisriou famille Boisseau (Bouesseau) Guérin Boiséon de famille Bonneval Foucauld de Bor de, famille Boterel de Quintin famille Boucher François Bouesseau (Boisseau) famille Bouhaim, Enguerrand de Bouhaim, Michel de Boulogne Eustache III de Boulogne Flour de Boulogne Gerberge de Boulogne Godefroy de (Godefroy de Bouillon) Boulogne Héliges de Boulogne Ide de Boulogne Mathilde de Bourbon Blanche de Bourbon Catherine de Bourbon Charles II de Bourbon Charles Ier de Bourbon Charlotte de Bourbon Isabelle de Bourbon Jacques de Bourbon Jean II de Bourbon Jean Ier de Bourbon Jeanne de (princesse d'Orange) Bourbon Jeanne de (reine de France) Bourbon Jeanne de (épouse Guigues VII de Forez) Bourbon Louis II de Bourbon Louis Ier de Bourbon Louis de (évêque de Liège) Bourbon Marguerite de Bourbon Marie de Bourbon Mathieu de Bourbon Philippe de (Philippe de Beaujeau) Bourbon Pierre II de Bourbon Pierre Ier de Bourbon Suzanne de Bourbon famille de Bourbon, Louise de Bourbon-Condé famille Bourbon-Dampierre famille Bourbon-Montpensier Charles de (connétable de Bourbon) Bourbon-Montpensier Gilbert de Bourbon-Montpensier Louis de Bourbon-Montpensier famille Bourbon-Vendôme Jacques de Bourbon-Vendôme Jeanne de Bourbon-Vendôme Louis de Bourbon-Vendôme famille Bourdin, Marguerite Bourgogne Agnès de Bourgogne Anne de Bourgogne Bonne de Bourgogne Béatrice de Bourgogne Hugues IV de Bourgogne Jean Ier de (Jean sans Peur) Bourgogne Philippe de Bourgogne, Marguerite de Bourgogne, famille de Bourigan du Pé famille Boutou Charlotte Boutou famille Bouvenot Guillaume Brabant Adélaïde de Brabant Henri III Brabant Marie de Bressolles Louise de Bretagne François II duc de Bretagne François Ier de Bretagne Jean IV de Bretagne Jean V de Bretagne Marguerite de Bretagne de Bretagne, Anne de Bretagne, Arthur III de Brilhac (Brillac), famille Brisay (Brizay), famille Brizay, Aimery de Briçonnet Jeanne Briçonnet, famille Brochard de la Rochebrochard famille Broucin Béatrix de Brunswick Otton de (Otton IV empereur) Bucy Renaud de Bucy Simon de Budes, Jeanne de Budé Jean Budé famille Budé, Jacquette Bueil Jean VI (alias V) de Bueil Louis III de Bueil Pierre de Bueil de famille Bureau Jean Béarn Jeanne de Béarn famille Caillet, René Cambray Adam de Campremy famille Cancoët famille de Carcassonne famille Cardeurs confrérie (Ormes - Aube) Carit Bernard Castille Alphonse X de Castille et León Chabanais Jacques de Chabanais Troïlus de Chabert Hugues Chabot, Guillaume Chabot, famille Chaillé, famille Chalençon Bertrand de Chambellan, Madeleine de Chambly famille Chambly, Isabeau de Chambly, Louis de Chamborant, famille Champagne, Clérambault de Champagne, Jacquette de Champagne, famille Champluisant Arthur de Chanac (Chenac) Pierre de Chandos, John Chantefin famille Chaperon, Jean Chaperon, famille Chapitre Notre-Dame-la-Grande Chapitre Notre-Dame-la-Grande de Poitiers Chapitre Saint-Pierre de Chauvigny Chapitre Sainte-Radegonde de Poitiers Chapitre cathèdrale Saint-Just de Narbonne Chapitre de Montbrison Chapitre de la cathédrale Saint-Gatien de Tours Chapitre de la cathédrale de Luçon Chapitre de la cathédrale de Poitiers Chapitre métropolitain de Sens Chareles, famille Charlemagne Charles IX roi Charles V roi Charles VI, roi Charles VII, roi Charles VIII roi Chasteigner Geoffroy Chasteigner Jean III Chasteigner René Chasteigner, famille Chateaubriant famille Chateauneuf Hugues de Chauvelle, Jeanne Chauvigny Antoinette de Chevalier, Jean Chevalier, famille Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem Chevaliers de l'Ordre du Temple Chevredent (Chevredant), famille Chissé Jean de Châteauneuf - Alleman Châteauneuf famille Châteauvillain, famille Châtelet famille Châtillon Gaucher de († 1377) Châtillon Jean de († 1363) Châtillon, famille Citoys René de Citoys famille Claveurier, famille Clerey famille Clermont Jeanne de Clermont Robert de Clisson Béatrix de Clisson Olivier de Clovis Ier roi des Francs Cluys Geoffroy III de Coatrédrez Coatrédrez, Yves de Colombiers, famille Combarel Pierre de Combarel, Hugues de Combarel, famille Comminges Comtes de Vintimille Comtes du Poitou Confrérie des vignerons (Champagne) Coquevil Gilles Corbeau famille Cornil famille Corporation des bouchers de Loudun Corporations des bouchers d'Amboise ? Cossé Angélique de Cossé-Brissac Arthur de Coucy Raoul II de Coucy, famille Coëtivy Typhaine de Coëtmen Jean II de Coëtmen Jean Ier de Coëtmen Prigent de Coëtmen Rolland V de Coëtmen de Coëtmen famille de Coëtmenec'h famille de Coëtmeur famille de Coëtnempren de Creac'hingar famille de Craon famille de Crevant Louis Ier de Crozet Catherine de Crény (Creney) Michel de D'Arces famille D'Attainville famille D'Auvray, famille D'Aux Fort (Fortius) D'Aux, Pierre (?) D'Uriage famille Dainville Jean de Dammartin Mathilde de (Mathilde de Boulogne) Dampierre Jean (grand queux de France) Dauphin de France Dauphiné de Viennois De Bourchenu De Gennes famille De La Tour d’Olliergues Guillaume De Nevelet De l'Isle-Adam, Adam De l'Isle-Adam, Adèle De l'Isle-Adam, Ansel De l'Isle-Adam, Gasse De l'Isle-Adam, Jeanne De la Béraudière, famille De la Chaussée (Chausse) Marguerite De la Noüe Odet De la Queue famille De la Rivière, famille De la Roche, Amenon De la Roche, Robert De la Roche, famille De la Touche - inconnue De la Touche famille De la Tour Bertrand IV De la Tour Bertrand VI De la Tour Bertrand VII De la Tour Jean Ier De la Vernande famille Denis ou Denys Françoise Derval famille de Des Plantes, Philippe Des Près Jean Des Prés Pierre Desprez) Dinan-Montafilant Marie de Dinteville, Claude de Disney, William Dodieu d'Espercieu Claude Dormans Guillaume de Dormans Jean de Doucet, Guy Doucet, Jean Dreux Robert III de Dreux, famille Du Bec, famille Du Bellay Catherine Du Bellay Jean Du Bois du Dourdu famille Du Chaffault Pierre Du Chastel / inconnu Du Chastel Bernard Du Chastel François Ier Du Chastel Guillaume II Du Chastel Marguerite Du Chastel Olivier II Du Chastel Olivier Ier ou Tanguy Ier Du Chastel Tanguy Du Chastel Tanguy - cadet - Du Chastel Tanguy II Du Chastel Tanguy III Du Chastel famille Du Fau Ladislas Du Fou Yvon Du Fou, François Du Fou, Jacques Du Fou, Raoul Du Fou, famille Du Four Catherine Du Four Jean Du Garo famille Du Houlle famille Du Houlle-? Du Juch Marie Du Mas de Naussac famille (branche cadette ?) Du Moulin, Angès Du Pont Marie Du Portal Jean Du Portal Simon Du Pouget Bertrand Du Prat Guillaume Du Puy Jean Du Puy René Du Refuge famille Du Rouazle famille Du Vernay Pierre Dupuy, Madeleine Duré, Robert Duèze de Carmaing famille Duèze de Carming Arnaud II Écosse Marie de Écu inscrit Église (pape) Elyngton famille Empereur Empire Enseigne Entenza (Entença) famille Escoubleau de Sourdis Henri Espinay André de Espinay Charles de Espinay famille de Estaing François de Estissac, Geoffroy d' Estouteville famille Etienne de Bourgueil Evreux Evreux Louis de Évreux Marguerite de Evreux Philippe de Evreux d'Etempes Charles de Evreux-Navarre Charles de Evêché de Strasbourg Farnèse Paul III pape Felton, William Fleury Jean Florent de France Florigny (Fleurigny) Philippe de Foix Bertrand III de Foix Gaston Ier Foix famille Foix-Béarn famille Fontenay famille Forez Anne de (Anne Dauphine d'Auvergne) Forez Guy IV de Forez de famille Foussy Jean de (Jean de Toussiaco ?) France Anne de (Anne de Beaujeu) France Robert de (Robert de Clermont) France, Claude de France-Bourbon François Ier roi François de France (François III de Bretagne) François de France dauphin Fresneau Louis Frise Adélaïde de Frotier (Frottier) famille (brisure) Frotier (Frottier), famille Frotier Guy Frotier Jean Frédol (Frézouls) André de Frétard, Huguet Frétard, Pierre Frétard, Robert Frétard, famille Fumé, François Fumé, famille Gaboreau (Gaboriau, Gabareau), Pierre Gaillonnet, Regnault de Garnot Gaucourt Jean de Gay Audoin de Gaynac Jean de Gazeau, famille Genevois famille Gennes Émond de Genève Amédée IV de Genève de famille (ancien) Genève de famille (moderne) Ghistelle, Jeanne de Gillans, Simon de Gillier famille Girard (de la Roussière) famille Girard Jean (Jehan) Girard Jean III Girard famille Gobelin Robert Goheau Jean Gon Etienne Gonzague Claire de Gouffier Aymar Gouffier famille Gouges de Charpaigne, Guillaume Gouges de Charpaigne, famille Goulhezre famille de Gourgaud (Gourjault, Gouregeault), famille Goyau famille Grasse Pierre de Grave de famille Grignon famille Grossoles Herrard de Guillin, Jean Guyomarc'h Catherine Guyomarc'h alias Guiomar de La Petite Palue famille de Guérault famille Hainaut Marie de Halewin (Halewin, Halewijn), Bernard Hamelin Florent Hangest, famille Hannequin Jean II Hannequin famille Harcourt Beaumesnil Harcourt Guillaume de Harcourt Jean II d' Harcourt Jean de (évêque de Narbonne) Harcourt Philippe de Harcourt famille (brisure) Harcourt, famille Hastelou Marie Haudoin famille (branche cadette ?) Henri II roi Herbert, Simon Herbert, famille Herbiers, André des Holland Jeanne Hospitaliers Huon de Kermadec Pierre Huon de Kermadec famille Hurault Jean Hurault, Philippe II Illiers Miles (Milon) de Inconnue - Moussy Janoilhac, Jeanne Jay Philippe Jay famille Jay, Jean Jean II le Bon, roi Jean de Dunois Jean de France (+ 1364) Jeanne de France Jeanne de Penthièvre Joubert de la Bastide, Mathurin II Jourdain (Jourden), Guillaume Jousserant, Jaques Jouvenel des Ursins François Jouvenel des Ursins Guillaume Jouvenel des Ursins Jean Jouvenel des Ursins Louis Jouvenel des Ursins, Jacques Jouvenel des Ursins, famille Juste famille Kaeraubars (Kerambar, Kerambars) Yvon de Keraëret ou Kerazret famille de Kergoal famille de Kergoal seigneurs de Kergorlay Amice de Kergounouarn de famille Kergournadec'h famille de Kergroadez famille de Kerguiziau (Kerguisiaux, Kerguisiau), Henry de Kerguiziau Alain de Kerguiziau de-armoirie inconnue Kerguiziau famille de Kerlec'h Guillaume de Kerlec'h famille de Kerliver Jehan de Kerliviry famille de Kerlozrec Jean de Kerlozrec Morice de Kermavan (ancien) famille de Kermavan Alain de Kermavan Jean de Kermavan Jeanne de Kermavan Tanguy V de Kermavan Tanguy de Kermavan Tanguy de († 1400-1401) Kermavan Tanguy de († vers 1461) Kermavan cadet de la famille de Kermavan de / Léon Kermavan famille de Kermellec famille de Kerneguez, Olivier de Kernezne, Jean de Keroulay, Jean de Kerouzéré Eon (alias Yvon) de Kerouzéré famille de Kerret famille de Kersaliou Marie de Kersauzon famille de L'Hermite, famille L'Hermite,Tristan Louis L'Isle Jourdain Marguerite de L'Isle Jourdain, Huguette de L'Isle-Adam famille L'Orfèvre Anne La Chapelle famille de La Fayette, Guillaume de La Ferté famille La Forest Louise de La Haye, John de La Marche Thomas de La Marche-Lusignan Guy de La Mure famille La Palue François de La Palue Françoise de La Palue famille de La Perreuse Jean de La Roche Simone de La Roche-Jaubert, Pantaléon de La Rochefoucauld Marguerite de La Rochefoucauld, famille La Sudrie famille La Taste Catherine de La Tour Bertrand IV de La Tour d'Auvergne Anne de La Tour du Pin La Tour-Landry famille La Vernade Louis de La Vieuville Pierre de Lalande Lalande, Louise de Lancastre Jean de (duc de Bedford) Langalla Yvon de Lannorgant famille de Lannoy Marie de Lansulien famille de Larcher, Hilaire Larcher, Jean Largentier famille Lauzon (?), famille Laval, famille Laval-Loué, Thibault de Le Barbu famille Le Bourguignon Jeanne Le Bé Nicolas Le Chever Merien Le Coq Hugues Le Despenser, famille Le Duc Guillaume Le Folmarié, Jacquette Le Folmarié, Jeanne Le Forestier, Alain Le Gluydic famille Le Gras Marie Le Lec'h alias Le Heuc famille de Le Maesconval, Le Mescoual famille Le Maître Jean Le Mercier famille Le Moyne de Rannorgat Olivier Le Moyne de Rannorgat Tanguy Le Moyne de Rannorgat famille Le Normant du Rouazle Alain Le Normant du Rouazle Yvon Le Picart Catherine Le Picart, Jean Le Prévost Le Prévost, Jeanne Le Saunier Jean juge Le Saunier Pierre Le Saunier famille Le Saunier, Guillaume Le Saunier, Guillemin Le Saunier, Jean (+ 1340) Le Ségaler Raoul Le Venier famille Le Veyer Jehanne Le Viste Jean Leblanc, Catherine Lescoët de Kergoff Marguerite de Lescoët famille de Lesguern et alliance inconnue famille de Lesguern famille de Lespinay Jean de Levesque, famille Levrault, Jean Lezay (de l'Isle-Jourdain), famille Ligier de Boulogne Lignières de famille Limbourg Waléran de Loisel Pierre Longuejoue, Guillaume de Lorfevre (L'Orfèvre, L’Orphevre) Valentine Louis IX roi Louis XI roi Louis XII roi Louvemont famille Lovetoft famille Lusignan Léon de Lusignan, Geoffroy II de Lusignan, Geoffroy II de (A la Grande Dent) Lusignan, famille Luxembourg-Saint-Pol, Catherine Léon Ame ou Constance de Léon Amé de Léon famille de Lévis Guy III de Lévis Philippe de Lévis famille Lévis-Couzan Jean de Lévis-Lavieu Eustache de Lézignac, Louis de L’isle Jourdain, famille Machecoul Machecoul famille de Macé, Jean Mage famille Magnac, famille Maillé Hardouin IX de Maillé Jeanne Maillé famille Majorque Jacques II de Malestroit famille de Malevente (ou Malevende Maluenda) Mallet de Graville Manhac, famille Marafin Jeanne de Marc'hec famille Marconnay, famille Mardeilly Jeanne de Mareuil Louise de Mareuil, Ithier de Marguerite (femme de Pierre Loisel) Marie ... femme de Pierre Le Saunier Marigny Philippe de Marmande, famille Massaut Gilibert de Mauconduit Michel Mauroy Pierre Mauvoisin famille Menou Louis de Mercœur famille Mesnoalet famille de Meyos, Guy de Millet, Eustache Millet, Jean Millet, Jeanne Moisan famille Mol famille Mol-inconnu Mollins famille Molé famille Mongies, famille Monstier Jean de Montberon Catherine de Montberon, Charles de Montberon, famille Montbrun-des-Corbières famille Montdragon Troïlus de Montdragon famille de Montejean Jeanne de Montfort de Lestourdu famille Montfort famille Montlezun (Monlezun) Pierre de Montléon (Monléon), famille Montléon, Joachim de Montmorency Anne de Montmorency, Charles de Montrelais de Jean Montrevel dit L’Ermite de La Faye, famille Morillon famille Morinault - inconnue Morinault, Jean Morlet de Museau Mortemer (Morthemer), famille Moulins Philippe de Mourraut (Mouraud, Moraude) Anne Mourraut (Mouraud, Moraude) famille Moussy - inconnue Moussy, Jean de Mullenheim Jean Ulrich de Murat de Lestang de Pomairols Gabriel de Médicis Léon X pape de Mérichon, Jean II N. femme de Guillemin Le Saunier Narbonne Aymeri IV vicomte de Nation de Normandie (Université de Paris) Navarre Navarre Charles II de Navarre Jeanne Ière de Navarre Jeanne de (+ 1437) Navarre Philippe III de Navarre Pierre de Neauville Hervé de Nesle (Néelle), Jeanne de Nesle de famille Nevelet famille Noailles, famille Noroy Charles de Négrand de Couhé, Pierre Okested, famille Omnès de Keroullé Françoise Omnès de Keroullé Jacob Omnès de Keroullé Marie Ordre de Saint-Jean de Jérusalem Orléans Charles de Orléans Charles de (comte d’Angoulême) Orléans Jean de Orléans Louis Ier de Orléans Philippe de Orléans famille Orléans, Anne d' Orléans-Longueville François II de Orléans-Longueville François Ier de Orléans-Longueville Henri Ier de Orléans-Longueville Renée de Orléans-Longueville, famille Paillard Germain Pajot famille Paparin de famille Parthenay Jean de Parthenay, Marie de Parthenay-L’archevêque, famille Pauquette de Soulatgé famille Peccat Agnès Peccat famille Pelloquin, Jacques Pelloquin, famille Penancoat de Keroual Louise de Penanneac'h Catherine de Penaot, Pennault, Penn-Eauc'h famille de Penmarc'h Aliette de Penmarc'h de famille Pennaneac'h Marguerite de Penthièvre famille Perdrier, Jean Philippe IV roi Philippe VI Picot Piedefer Robert Piedefer famille Pinot Gillette Pinot famille Plasensac Simon de Pleurre Anne Marie de Plusquellec Jehan de, sieur de Bruillac Plédran famille de Pochard, Hervé Polignac (Poulignac), Louise de Poncher Etienne Pons Esther de Pons Gillebin de Pons Lucrèce de Pont Jeanne du Pontmolin Thibault de Pontsal Yves de Porchère Jeanne Portugal Alphonse III de Pot famille Pot, Jeanne Potier, Nicolas Poulmic Marie de Poussard Charles Prat Géraud de Preuilly Preuilly Agathe de Preuilly Louise de Preuilly, Eschivard VI de Priam Yves de Prie de famille Prie de, Sarrazine de Prie de-Inconnu Prie de-Preuilly Prieuré Saint-Laurent de Parthenay Prieuré Saint-Pierre de Cheffois Prissay de famille Provence Marguerite de Provence, famille Provost Provost, François Pérusse (Peyruse) des Cars, famille Péréfixe, Marc de Quilbignon de Coatenez Méance de Quélen Aliette de Rabot Bertrand Rabot famille Raguier, Antoine Raguier, Hémon Rancon, famille Ratault Bertrand Ratault famille Ravenel famille Refuge (Reffuge) François de Reine de France Ricard de Gourdon de Genouillac Ricard de Gourdon de Genouillac Jacques (dit Galiot) de Richemont, Arthur de Rieux Marie de Rieux famille de Riglet Nicolas Rivoalen Jeanne de Robertet Jacques Robertet Jean Rochechouart (brisure) Rochechouart, Jean Ier de Rochechouart, famille Roger Hugues Rogier, Jean Rogier, famille Rohan Alain IX de Rohan Alain VIII de Rohan Jean Ier de Rohan Marguerite de Rohan famille Rohan-Chabot Louis de Roi Arthur Roi de France Roi de Naples Roigne de Boisvert, Mathurin Roquefeuil famille Rosmadec de Goarlot Jeanne de Rostrenen famille de Rouault André Rouault Jean Rouault Marguerite Rouault Tristan Rouault famille Roucy (Roussy) de famille Roucy (Roussy), Jeanne de Roussay Jean de Rousseau de la Parisère Pierre Rousseau de la Parisère René Roye, famille Royrand, Nicolas Royrand, famille Rubempré Jeanne de Ruggieri Cosimo Rusoi famille Ruzé, Catherine Ryon (Riom), famille Sacierges, Pierre de Saint-Belin Geoffroy de Saint-Brice Nicole de Saint-Brice famille Saint-Marcel Claude de Saint-Mathieu abbaye de Saint-Nouay famille de Saint-Savin, famille Saint-Tirier Anne de Sainte-Marthe Gaucher de Sainte-Maure Guillaume de Saissac Jourdain de Salazar Tristan de Salignac famille Sancerre, famille Sanguin famille Sathanay, Jean de Saugeres, Pierre de Savoie Louise de Savoie Madeleine de Savoie famille Savoie, Charlotte de Saxe famille de Scépeaux Jeanne de Scépeaux famille Seigneurs de Civray Sens Gilles de Sens Guillaume de Sforza famille Souvré Antoinette de Soyécourt famille Stauffenberg famille Stuart John Séguier, Nicolas Sénéchal, famille Talec (Ialec), Henri Tanguy famille Targé Jeanne de Taveau, famille Teinturiers confrérie (Ormes - Aube) Texier, Aimery Thieuville Guillaume (de Guéhébert) Thouars Péronnelle de Thouars, famille Tiercelin François Tiercelin, Charles Tiercelin, famille Tiercelin-Turpin, famille Toucheboeuf Jean de Troguindy famille de Trolong famille de Tromelin famille de Trousseau, Pierre de Trussell, William Trésiguidy Jean de Trésiguidy Marguerite de Trésiguidy famille de Tudert, Joachim Turpin Charles Ier Turpin Martine Turpin, Anne Turpin, famille Tyvarlen (Tyvarauten), Guillaume de Université de Poitiers Vabres Michel de Valence-Lusignan Guillaume de Vallangoujard (Valengoujard), Thibaut de Vallangoujard Valengoujard Girard de Vallangoujard Valengoujard Thibaut II de Valois Isabelle de Valois Jeanne de (Jeanne de France) Valory, famille Varèze, Jeanne de Varèze, famille Vassan famille Verdiers, famille Verduzan Gaston de Versailles Guy de Veyny d’Arbouze Françoise de Vezançay, Guillaume de Vichier, Renaud de Vigeron, famille Vigénes Jean de Ville d'Aigueperse Ville de Beauvais Ville de Luçon Ville de Montpellier Ville de Niort Ville de Paris Ville de Poitiers Ville de Tours Villeblanche Antoine de Villeneuve, Simon de Villiers Ancel de Villiers Dreux de Villiers Jean de (+ 1360) Villiers Jean de (+ 1369) Villiers Jean de (+ 1375) Villiers Pierre de Villiers de l'Isle-Adam, Charles de Villiers de l'Isle-Adam, Jacques de Villiers de l'Isle-Adam, Jacques de Villiers famille Villiers, Ambroise de Villiers, Antoine de Villiers, Éléonore de Vinols de famille Visconti Valentine Visconti famille Vitry Michelle de Vivonne Savari III de Vivonne, famille Voisin Guillaume de Wetzel von Marsilien Clara/Agnès Wtwiic Arnold de Zäringen Berthold IV de de Gondy Marguerite-Françoise de Kerlec'h de Kerlec'h François de Kerlec'h Guillaume de Kermenou Leveneze du Drénec de Kerourien famille du Pont Louise du Pou famille du Pou-inconnu du Rest Jacques du Rest Salomon du Rest famille du Rouazle Louise du du Tertre famille